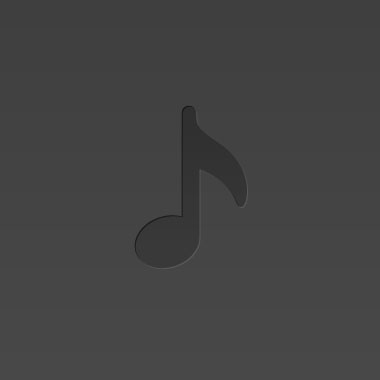Santé
Environ 30% de la population sans eau et savon face à la pandémie

Environ 30% de la population mondiale n'a pas eu accès à du savon ou de l'eau potable chez elle pendant la pandémie. D'ici 2030, des milliards de personnes seront affectées si le taux de progression ne quadruple pas, a averti jeudi à Genève l'ONU.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), environ un quart des personnes manquaient l'année dernière d'eau potable sûre dans leur habitation. Près de la moitié n'avaient pas de dispositif d'assainissement des eaux adapté, alors que la pandémie a montré le besoin de garantir une hygiène pour tous.
"Nous ne sommes pas en ligne" avec les objectifs de garantir un accès pour tous d'ici 2030, a dit à la presse la directrice de la santé à l'OMS, Maria Neira. Des centaines de milliards de francs par an sont requis pour tenter de les atteindre. Chaque année, plus d'1,2 million de décès pourraient être évités.
Un investissement dans les infrastructures sur cette question doit être un chantier "mondial" face au coronavirus, a estimé de son côté le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Avec la pandémie, "tous les pays vont finalement comprendre" que ses dépenses en valent la peine, renchérit Mme Neira.
"Le seul moyen de réduire notre vulnérabilité face à une potentielle prochaine pandémie ou même la crise actuelle du changement climatique" est de garantir un accès à l'eau et à l'assainissement des eaux, ajoute-t-elle. Selon un responsable de l'UNICEF, il est prématuré d'évaluer l'effet du coronavirus sur l'accès à l'eau potable ou à l'assainissement des eaux.
Quelques avancées récemment
Un quart des personnes en Afrique disent avoir eu "bien davantage" de difficultés, affirme-t-il. Plusieurs pays ont lancé des feuilles de route pour évaluer où ils devaient injecter des financements pour améliorer les dispositifs d'hygiène.
Certains ont subventionné aussi l'approvisionnement en eau. Ils ont aussi interdit une interruption sur celui-ci en cas de non-paiement par les clients. Ce dispositif contribue à sécuriser les personnes mais pourrait, s'il n'est pas compensé financièrement, mettre en difficulté les prestataires, dit un responsable de l'OMS.
Quelques avancées ont été obtenues depuis 2016. L'accès à l'eau potable chez soi a augmenté de 70 à 74% jusqu'à l'année dernière. Celui à l'assainissement s'est étendu de 47 à 54% et les infrastructures avec savon et eau de 67 à un peu plus de 70%.
L'année dernière, pour la première fois, davantage de personnes ont utilisé des dispositifs sur site, mieux dotés pour les déchets, que des connexions aux égouts. Les gouvernements sont appelés à davantage de soutien.
Afrique largement affectée
Sans investissement, 1,6 milliard de personnes n'auront pas accès à l'eau potable chez elles d'ici 2030. Près de 2,9 milliards n'auront pas d'assainissement adapté des eaux et près de 2 milliards n'auront pas de savon ou d'eau chez elles.
Dans les pays affectés par des conflits ou des désastres, le taux de progression doit être multiplié par plus de 20. La directrice exécutive de l'UNICEF appelle à "accélérer" les efforts.
Parmi les autres données, 80% des personnes qui manquent de dispositifs adaptés se trouvent dans des zones rurales. En Afrique subsaharienne, seules 54% des personnes ont accès à une eau potable sûre et un quart seulement dans les zones difficiles.
Les deux organisations appellent les décideurs des agences internationales, des gouvernements, de la société civile et du secteur privé à oeuvrer. Une conférence internationale est notamment attendue dans deux ans.
Santé
Briser les stéréotypes autour de l’autisme

Mettre en évidence la nécessité d'améliorer la vie des enfants et des adultes autistes: tel est le but de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui se tient le 2 avril.
La Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, c'est l’occasion de faire connaître ce trouble neurodéveloppemental à la population et de briser les stéréotypes. Comme l'explique Autisme Suisse romande, l’autisme comprend un éventail de particularités cognitives d’intensité très variable, toutes regroupées sous le terme générique de Trouble du Spectre Autistique (TSA).
Selon Autisme Europe, ce trouble touche un enfant sur 100. Difficile cependant d'établir un chiffre pour le canton de Vaud.
En terre vaudoise, peu d’institutions reconnues font des diagnostics et la situation est compliquée. S'il n’existe aucun traitement médicamenteux pour l’autisme, les associations prônent pour davantage de stratégies éducatives et pour la formation de spécialistes.
Autisme Vaud est la section cantonale de l’association Autisme Suisse romande, qui œuvre pour les droits et l’amélioration de la qualité de vie des personnes avec autisme et leur famille. Elle met notamment à disposition une helpline.
Lausanne
PFAS dans les sols et l'eau mais pas de risque pour la population

Le site du Centre de formation de la Rama, à Montheron (Cugy), est pollué par des PFAS. La Ville de Lausanne rassure toutefois: il n'y a pas de risque au niveau de l'eau du robinet.
Le Centre de formation de la Rama est utilisé par les sapeurs-pompiers pour des exercices. Des préoccupations ont été émises concernant les PFAS dans cette zone, car on retrouve notamment ces produits dans les mousses anti-incendie. C’est pour cela que le site de la Rama a été analysé. Des évaluations menés par le Service de l'eau, le Service de protection et sauvetage (SPSL) et l'Unité environnement de la Ville
de Lausanne, en collaboration avec la Direction générale de l'environnement de l’Etat de Vaud. Et les tests ont confirmé la présence de ces PFAS dans les sols et les eaux.
Pour rappel, il s’agit de produits chimiques polluants éternels, connus notamment pour leurs propriétés hydrofuges, antigraisse et antisalissure. Mais concernant les résultats, Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de la sécurité et de l’économie, se veut rassurant.
Il n'y a effectivement pas d'usage à risque du site, comme une place de jeu où les enfants risqueraient de porter de la terre à la bouche. Il n'y a donc pas de risque pour les sapeurs-pompiers qui s'exercent.
Une pollution qui date et qui reste
Le problème principal de ces PFAS, c'est qu'ils ne se dégradent pas naturellement. D'ailleurs, la pollution du site de la Rama ne date pas d'aujourd'hui. On l'a dit, les mousses extinctrices contiennent des PFAS. Celles comportant les substances les plus problématiques ne sont plus utilisées dans le Canton de Vaud depuis 2011, mais on peut dire que "le mal était fait".
"Ils ne perdent pas leur caractère dangereux, développe Pierre-Antoine Hildbrand. On a quelque chose qui s'accumule dans les tissus des animaux par exemple. Et nous, on est en bout de chaîne alimentaire et on risque de développer des cancers ou des maladies à force d'accumuler ces substances dans notre corps."
Le Canton de Vaud a donc inscrit le site au cadastre des sites pollués comme «site pollué, nécessite une investigation». Qu’est-ce que ça signifie? Les explications de Pierre-Antoine Hildbrand.
D'après les observations et la topologie du site, les risques de propagations sont cependant faibles.
De manière plus large, ces produits posent également problème du côté du droit. Il n'y a en effet pas de bases légales spécifiques au niveau fédéral pour les PFAS dans le sol. "Nous découvrons cette pollution. Les pays qui nous entourent, les pays européens, les États-Unis, la Grande-Bretagne, sont plus avancés que nous face à ce phénomène et ont mis des normes plus élevées. Il faut qu'on s'aligne sur ces normes pour continuer à bénéficier d'un environnement sain."
S'il est nécessaire de traiter cette question à l'échelle du pays, cela n'a pas empêché la Ville de s'aligner sur nos voisins européens.
Santé
L'Association suisse des fibromyalgiques appelle à l'aide

Les personnes atteintes de fibromyalgie souffrent d’un manque de reconnaissance: alors que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la maladie, ce n'est pas le cas de l'Assurance Invalidité en Suisse.
La fibromyalgie touche entre 1 et 5% de la population dans les pays industrialisés occidentaux, et les femmes sont deux à cinq fois plus touchées que les hommes. La maladie provoque notamment des douleurs musculaires, comme l'explique Philippe Schüpbach, président de l’Association suisse des fibromyalgiques.
La fibromyalgie est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, mais pas par l’Assurance Invalidité en Suisse. Un réel problème, selon Philippe Schüpbach.
Plus d'informations sur le site de l'Association suisse des fibromyalgiques.
Santé
Briser le tabou autour de la prématurité

C’est la Journée mondiale de la prématurité, une situation qui concerne une naissance sur dix dans le monde. Et qui est souvent difficile à vivre pour les parents.
Un bébé sur dix naît de manière prématurée, c’est-à-dire avant 36 semaines de grossesse. Et l’association Né trop tôt a été créée pour accompagner les parents de bébés nés prématurément et hospitalisés en néonatologie. Les bénévoles de l’association sont tous des parents qui ont vécu une naissance hors norme. Ils apportent du soutien matériel, mais aussi et surtout émotionnel, car l’expérience peut s’avérer traumatisante pour les parents. Cristina Guillet, coordinatrice générale pour l’association Né trop tôt.
Le sujet de la prématurité reste tabou, même dans le milieu médical.
Cristina Guillet nous explique par quel biais les parents sont soutenus par l'association "Né trop tôt".
L’association "Né trop tôt" organise aussi régulièrement des cafés-discussions. Ce vendredi 17 novembre, à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, elle est présente au CHUV à Lausanne, aux HUG à Genève, Pourtalès à Neuchâtel, au HFR à Fribourg et dans les établissements du Nord-Vaudois à Yverdon pour faire de la sensibilisation.
-
VaudIl y a 2 jours
31 communes suspendent leur contribution à la facture sociale
-
InternationalIl y a 3 jours
L'objet qui a transpercé un toit en Floride vient de l'ISS
-
ÉconomieIl y a 2 jours
Accuray inaugure un nouveau pôle à Genolier (VD)
-
VaudIl y a 3 jours
Les vieilles voitures paraderont à Cossonay pour le Grand Prix TCS
-
HockeyIl y a 2 jours
Des regrets légitimes pour le Lausanne HC
-
GenèveIl y a 2 jours
Genève sonde les personnes âgées pour adapter sa politique
-
PeopleIl y a 2 jours
"C'est une personne magnifique" : Jessica Chastain chante les louanges d'Anne Hathaway
-
VaudIl y a 2 jours
Le pilier public doit se mettre à l'heure du numérique